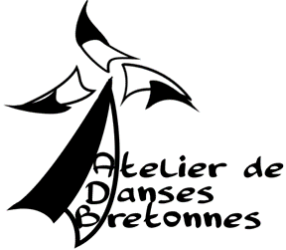Publié le 4 août 2025 à 17h30 par :

Bretagne : pourquoi le nom de nombreuses communes commence-t-il par « Plou » ?
Pourquoi retrouve-t-on tant de noms de villes bretonnes débutant par « Plou » ? Ce préfixe intrigant, hérité d’un passé lointain, cache une histoire fascinante de communautés, de saints oubliés et d’organisation territoriale. Plongée dans les racines linguistiques de la Bretagne.
Plouha, Plougonvelin, Ploufragan, Plouescat… Si vous avez déjà roulé sur les routes de Bretagne, impossible de passer à côté de ce drôle de préfixe qui fleurit sur les panneaux d’entrée de ville : « Plou ». En apparence anodin, ce petit mot en dit long sur l’histoire de la région. Car derrière ce « Plou » omniprésent se cache un vestige linguistique du haut Moyen Âge, issu du vieux breton pluiu, qui signifiait alors « paroisse » ou « communauté de fidèles ». Un indice précieux sur la manière dont la Bretagne s’est structurée dès les premiers siècles de notre ère, sous l’influence du christianisme et des migrations celtiques venues des îles Britanniques. En creusant un peu, on découvre que ces « Plou » révèlent à la fois la carte religieuse et sociale d’une Bretagne en pleine formation. Alors, que nous racontent vraiment ces noms de communes ? Et pourquoi sont-ils si nombreux à débuter ainsi ? Réponse dans cette exploration toponymique, entre histoire, religion et identité régionale.
Le sens caché du préfixe « Plou » dans les noms de communes bretonnes
Le préfixe « Plou- » provient directement de l’ancien breton. Il tire son origine du mot pluiu, issu du latin plebs, plebis, qui signifiait « paroisse » ou « communauté ». Ce terme a ensuite évolué en ploe en moyen breton, avant de devenir « Plou- » dans la langue actuelle. Il désignait les premières paroisses chrétiennes établies dès l’arrivée du christianisme en Bretagne, souvent fondées autour d’un prêtre ou d’un ermite devenu saint local. C’est pourquoi la majorité des communes bretonnes dont le nom commence par « Plou- » sont liées à un saint. Environ 80 % d’entre elles comportent en effet, après le préfixe, le nom d’un saint, parfois oublié aujourd’hui. On retrouve ainsi des localités comme Plougastel (« paroisse du château »), Plounévez-Lochrist (« nouvelle paroisse du lieu consacré au Christ »), ou encore Plouharnel, qui fait référence à Saint Armel, dont le nom signifie littéralement « prince aux qualités d’ours ». Cette manière de nommer les villes est très répandue dans l’ouest de la Bretagne, notamment dans les anciens évêchés de Léon, Cornouaille, Trégor et Vannes. Hors de Bretagne, ce type de formation toponymique est exceptionnel et ne partage pas les mêmes racines bretonnes.
Du préfixe « Plou- » au mot « plouc » : une histoire surprenante
L’origine du mot « plouc » est intimement liée à l’arrivée massive de Bretons à Paris à la fin du XIXe siècle. Près de 200 000 d’entre eux quittent alors leur région pour tenter leur chance dans la capitale, fuyant la pauvreté rurale. En mentionnant leurs villages aux noms commençant presque tous par « Plou-« , ils intriguent les Parisiens, peu habitués à ces sonorités. Peu à peu, « Plou- » devient une manière moqueuse de désigner ces migrants perçus comme frustes et inadaptés à la vie urbaine : les « ploucs ». Le mot finit par s’imposer comme un cliché englobant toute personne jugée provinciale ou sans éducation. Sa diffusion s’accélère lorsque Louis-Ferdinand Céline l’utilise dans Mort à crédit, publié en 1936, scellant son intégration dans le français courant.
Bécassine a-t-elle renforcé le mythe du Breton rustre et ignorant ?
Quelques années après cette vague migratoire, un autre élément va renforcer cette image caricaturale des Bretons : la création en 1905 du personnage de Bécassine. Cette héroïne de bande dessinée, habillée de sa coiffe traditionnelle et présentée comme naïve et simplette, incarne aux yeux de beaucoup l’archétype de la Bretonne candide venue de la campagne. Bécassine devient ainsi l’emblème de cette vision moqueuse et réductrice des Bretons, ce qui suscite la colère d’une partie de la communauté bretonne. En 1939, trois Bretons de Paris vont jusqu’à organiser une « expédition punitive » contre la statue de cire de Bécassine exposée au Musée Grévin, qu’ils détruisent en signe de protestation contre cette représentation jugée insultante.
D’autres mots bretons se sont-ils glissés dans la langue française ?
Au-delà de « plouc », le breton a largement infusé la langue française avec de nombreux mots, souvent issus de la culture et du quotidien breton. Parmi eux, on trouve :
- Baragouiner : de bara (pain) et gwin (vin), en référence aux Bretons tentant de commander à manger et à boire dans les bars parisiens.
- Menhir : de maen (pierre) et hir (long), utilisé pour désigner les fameux monuments mégalithiques.
- Goéland : issu de gwelan, qui signifie aussi « pleurer », évoquant le cri de l’oiseau.
- Cohue : venant de koc’hu, la halle des marchands bretons.
- Bijou : de bizoù, un anneau pour le doigt.
- Kenavo : qui signifie « au revoir » en breton.
- Biniou : nom breton de la cornemuse.
- Califourchon, cuche, pilou ou encore darne proviennent également de mots bretons adaptés au français.
Ces emprunts montrent la richesse du patrimoine linguistique breton et sa capacité à s’intégrer durablement dans la langue française. Toutefois, malgré cette influence, les Bretons d’aujourd’hui parlent un français très standardisé, sans accent régional marqué, selon les travaux du linguiste Mathieu Avanzi.